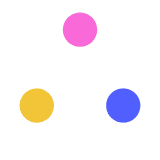
Boîte à outils - Interculturel
jmareschal
Created on March 8, 2021
jmareschal@cegepgarneau.ca
More creations to inspire you
Transcript
INTERAGIR EN CONTEXTE INTERCULTUREl Une boîte à outils interactive
3. Qu'est-ce que la communication interculturelle ?
4. expérimenter la communication interculturelle
7. pour aller plus loin
6. soyez les héros de vos propres expériences
5. Les clés de la communication interculturelle
1. présentation de la boîte
8. animer et organiser des ateliers de sensibilisation
2. pourquoi développer ses compétences ?
Bienvenue dans cette formation interactive !
1. Présentation de la boîte
Objectifs de la boîte
Comment naviguer dans la boîte ?
Matériel nécessaire (journal de bord)
Réalisation et participant(e)s au projet
OBJECTIFS DE LA BOÎTE À OUTILS En cohérence avec la devise du cégep Garneau : « Ici brille la diversité », ce projet vise à sensibiliser toute la communauté collégiale à la complexité des situations de communication interculturelle et à lui fournir les connaissances et compétences requises pour s’y sentir plus à l’aise et interagir de manière adéquate. Voici les objectifs : 1. Bonifier la formation :
- Améliorer la préparation et l’encadrement des étudiants en stage;
- Appliquer des outils de communication interculturelle en classe et lors de travaux d’équipe;
- Préparer les apprenants aux enjeux du monde du travail.
- Favoriser le développement de la sensibilité interculturelle pour une prise de décision éclairée;
- Créer un espace d’apprentissage autoportant, évolutif et pérenne.
- Contribuer au réseautage entre le personnel et les organismes ou personnes-ressources (internes et externes);
- Mobiliser la communauté autour d’enjeux liés à la diversité culturelle.
- Atténuer les micro-agressions et les situations ayant des effets discriminants sur le personnel et les étudiants issus de minorités culturelles;
- Développer une démarche de sécurisation culturelle.
Votre journal de bord Tout au long de la formation, vous serez invités à noter vos réflexions ainsi que vos nouvelles connaissances dans un journal de bord. Nous vous invitons à vous procurer un cahier pour prendre en note les informations que vous jugerez pertinentes ainsi que les réflexions qui émergeront des exercices.
RÉALISATION ET PARTICIPATION AU PROJET La boîte à outils a été réalisée par deux professeures d’anthropologie, Sarah Côté-Delisle et Julie Mareschal, en collaboration avec des personnes qui ont œuvré ou étudié au Cégep Garneau :
- Bassam Adam (professeur)
- Lhoussaine Dadaoui (professeur)
- Michèle D’Haïti (professeure)
- Jean-Didier Dufour (professeur)
- Maureen Hervieux (ex-étudiante)
- Cheikh N’Diaye (professeur)
- Kabamba Ngombo (ex-étudiant)
- Rosalie Picard (ex-étudiante)
- Jacinthe Poulin (conseillère)
- Medhi Touzani (ex-étudiant)
Écoutez nos experts parler de l'importance de développer ses compétences interculturelles
2. Pourquoi développer ses compétences interculturelles ?
EXERCICE
EXERCICE 1 - RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES INTERCULTURELLES Dans votre journal de bord, répondez aux questions suivantes 1. Qu'est-ce qui vous motive à développer vos compétences interculturelles ? 2. Dans quel contexte avez-vous à interagir avec des personnes issues d'autres cultures que la vôtre ? 3. En ce qui concerne la diversité culturelle, quels sont vos besoins professionnels et personnels ? 4. Avez-vous besoin de former ou d'accompagner d'autres personnes dans le cadre de vos fonctions ? Expliquez.
La communication interculturelle
La communication interculturelle représente un ensemble de compétences et d’habiletés qui nous permettent de prendre conscience de nos réactions devant la différence et de mieux comprendre celles de l’Autre dans le but d’ouvrir le dialogue et de négocier de manière équitable. (inspirée de St-Denis, 2006, p. 98)
8. Pour aller plus loin...
6. Les obstacles à la communication interculturelle
5. Le choc culturel
4. Communiquer en contexte interculturel
2. Qu’est-ce que la culture ?
1. Le point de départ : vos propres expériences
7. Démarche pour ouvrir le dialogue
3. L'ethnocentrisme, un miroir déformant
Dans votre journal, répondez aux questions suivantes : 1. Avez-vous déjà été en contact avec des personnes issues de d’autres cultures que la vôtre? Si oui, décrivez brièvement le contexte de ces rencontres. 2. Quelles sont les émotions que vous avez ressenties? 3. Quelles réactions, attitudes, ou comportements avez-vous observés (les vôtres et ceux d'autrui) lors de ces échanges ? 4. Que retenez-vous de ces rencontres? Votre souvenir est-il représentatif de la réalité selon vous ?
Qu’est-ce que l’ethnocentrisme ? Notre interprétation des attitudes et des comportements de l’Autre est souvent déformée par notre bagage culturel. C’est ce qu’on appelle l’ethnocentrisme. L’ethnocentrisme est une attitude universelle et souvent spontanée face à la diversité qui biaise ou « filtre » notre perception de la réalité et oriente nos réactions. La personne se base sur sa propre culture, c’est-à-dire ses propres normes, valeurs et façon de faire, pour interpréter et juger la culture de l’Autre. Un observateur qui a une attitude ethnocentrique ne tient pas compte du point de vue de l’Autre, parce qu’il n’est pas conscient de la différence (déni) ou parce qu’il considère que sa vision compte davantage. Que nous révèle notre ethnocentrisme ? Un regard ethnocentrique en dit souvent davantage sur notre propre culture (valeurs, normes, etc.) que sur celle de l’Autre. C’est d’ailleurs ce qui amène Edward T. Hall (1976) à affirmer que l’individu est un « être de projection ». * Une attitude ethnocentrique peut aussi être le signe que l’on vit un choc culturel. Il est important d’en prendre conscience.
Documents de référence sur la communication interculturelle Livres et articles de revues COHEN-ÉMÉRIQUE, Magalit. « L’approche interculturelle dans le processus d’aide ». Santé mentale au Québec, vol. XVIII, no. 1 (1993), p. 71-92. COHEN-ÉMÉRIQUE, Magalit, et Ariella ROTHBERG. La méthode des chocs culturels. Presses de l’EHESP, Rennes, 2015, 192 pages. EL-HAGE, Habib. Intervention en contexte de diversité au collégial. Collège de Rosement. 2018. https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/Intervention_contexte_diversite_collegial.pdf (page consultée le 12 avril 2020). GAUDET, Édithe. Relations interculturelles. Comprendre pour mieux agir. 4 édition, Éd. Modulo, Montréal, 2020, 168 p. GAUDET, Édithe et Louise LAFORTUNE. Pour une pédagogie interculturelle : des stratégies d’enseignement, Éditions du Renouveau pédagogique, Saint-Laurent, 1997, 426 p. HALL, Edward.T. Au-delà de la culture. Paris, Seuil, 1979, 234p. MELLOUKI, M’hammed. La rencontre. Essai sur la communication et l’éducation en milieu interculturel, Les Pesses de l’Université Laval, Québec, 2004, 176 pages. ROSENBERG, Marshall B. Les mots sont des fenêtres (ou des murs). Jouvence Éditions, Archamps, 2005, 271 pages. ROY, Louis, et Nadine TRUDEAU. Peuples et cultures, 3e édition, Éd. Modulo, Montréal, 2019, 416p. ST-DENIS, Karine. Culture et diversité. Initiation à l’anthropologie. Les éditions Anjou, CEC, 2006,196p. Sites internet AFS CANADA. Guide pour réussir son expérience culturelle. https://www.afscanada.org/guide-pour-reussir-son-experience-interculturelle/ (page consultée le 12 avril 2020). GOUVERNEMENT DU CANADA. Aperçu culturel. https://www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/services/cfsi-icse/cultural-insights-apercu-culturelles/index.aspx?lang=fra (page consultée le 12 avril 2020). UNIVERSITÉ LAVAL (BVE). Choc culturel et adaptation. https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/vivre-a-quebec/choc-culturel-et-adaptation/ (page consultée le 12 avril 2020). Documentaires et capsule vidéo HOUDE-SAUVÉ, Nicolas. Briser le code – Le documentaire. Télé-Québec. https://briserlecode.telequebec.tv/ (page consultée le 12 avril 2020). Télé-Québec. Briser le code – Le lexique. https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique. (Page consultée le 12 avril 2020).
La culture représente tout ce qui a été pensé et produit par l’être humain : les valeurs, les normes, les savoirs, les croyances, les symboles (matériel ou non), les attitudes et les comportements appris, transmis et partagés par les membres d’un groupe.
La culture
La culture comporte des composantes visibles et invisibles.
Définition inspirée de Hall (1976) et de Roy et Trudeau, (2019)
La culture varie dans le temps et dans l’espace.
EXERCICE
Composantes visibles
Composantes invisibles
Modèle tiré de Gaudet (2020)
Les composantes de la cultures Il existe de nombreuses composantes de la culture. Si plusieurs peuvent être facilement identifiables, telles que la langue, les lois, les règles et les rituels, d’autres demeurent invisibles, tout particulièrement pour le touriste ou le nouvel arrivant. C’est ce que Hall (1976) nomme la dimension cachée de la culture. La culture peut ainsi être comparée à un iceberg, qui comporte une dimension visible (façons d’agir) et une dimension invisible (façons de penser et de ressentir). L’image sur la diapositive montre que la majorité des composantes de la culture sont invisibles. Or, c’est dans cette partie que la personne y puise la plus grande charge émotive, ce qui explique qu’il est très difficile, pour quiconque, de remettre ces composantes en question. (Gaudet 2020)
La culture varie dans le temps et dans l’espace Par exemple, les valeurs et les normes québécoises sont bien différentes aujourd’hui de celles d’il y a 50 ans. De plus, les valeurs et les comportements observés en Chine sont bien différents de ceux présents au Québec. Variations au sein d’un même groupe culturel Chaque individu est unique ! Bien que la culture ait une grande influence sur la construction identitaire, l’individu se définit également par sa personnalité, ses propres expériences, de même qu’à travers son appartenance à des groupes sociaux (travail, sports, études, loisirs, organisation politique, etc.). Chaque groupe est unique ! Au sein d’une même société, il est fréquent de retrouver des sous-cultures, c’est-à-dire un « groupe d’individus qui adhèrent à des normes et qui adoptent des comportements qui diffèrent en partie de ceux qu’observe la majorité des membres de leur société » (Roy et Trudeau, 2019 : 69). Une sous-culture peut être un groupe religieux ou ethnique, mais aussi une organisation politique ou sociale (ex. mouvement punk). Ainsi, bien que l’on puisse observer plusieurs composantes communes aux membres d’un même groupe culturel, il faut éviter de généraliser les manières d’être et de penser. La prudence et la nuance sont des attitudes plus appropriées pour aborder les délicates questions identitaires et ouvrir le dialogue.
Exemples : - Langues - Rituels - Mode de vie - Comportements - Lois et règlements
Exemples : - Normes - Valeurs - Idéologies - Symboles - Savoirs - Croyances - Vision du monde
Dans votre journal de bord, faites l'exercice de réflexion suivant : À partir de l’image de l’iceberg, identifiez les composantes de votre culture que vous trouvez importantes. Y a-t-il des composantes que vous trouveriez difficile de négocier ou de remettre en question ? Pourquoi ? Comparez vos réponses avec un ou une collègue.
PROMENEZ-VOUS sur toutes les parties de l'image pour découvrir les « secrets » bien filtrés du processus de communication interculturelle.
La communication interculturelle représente un ensemble de compétences et d’habiletés qui nous permettent de prendre conscience de nos réactions devant la différence et de mieux comprendre celles de l’Autre dans le but d’ouvrir un dialogue et de négocier de manière équitable.
Source: Adapatation de Bourque (1989) tiré de Gaudet et coll. (1997)
This is a paragraph of text waiting to be awesome content
Source: Inspirée de St-Denis, 2006, p. 98.
J'ai une idée dans ma tête que j'ai envie de transmettre à mon interlocuteur.
Le message que j'envoie est teinté par ma culture, mes expériences et tous les autres aspects de mon identité: genre, âge, profession, etc. Exemple: Un Français dit à son collègue québécois: Hé! Tu veux voir une photo de mes gosses ? Voici l'image dans la tête de l'émetteur :
Je construis une idée dans ma tête à partir du message que je reçois de mon interlocuteur.
Le message que je reçois est teinté par ma culture, mes expériences et tous les autres aspects de mon identité: genre, âge, profession, etc. Exemple: Un Québécois entend son collègue Français lui demander : Hé! Tu veux voir une photo de mes gosses ? Voici l'image dans la tête du récepteur:
PROMENEZ-VOUS sur toutes les parties de l'image pour découvrir les « secrets » bien filtrés du processus de communication interculturelle.
La communication interculturelle représente un ensemble de compétences et d’habiletés qui nous permettent de prendre conscience de nos réactions devant la différence et de mieux comprendre celles de l’Autre dans le but d’ouvrir un dialogue et de négocier de manière équitable.
Source: Adapatation de Bourque (1989) tiré de Gaudet et coll. (1997)
This is a paragraph of text waiting to be awesome content
Source: Inspirée de St-Denis, 2006, p. 98.
J'ai une idée dans ma tête que j'ai envie de transmettre à mon interlocuteur.
Le message que j'envoie est teinté par ma culture, mes expériences et tous les autres aspects de mon identité: genre, âge, profession, etc. Exemple: Un Français dit à son collègue québécois: Hé! Tu veux voir une photo de mes gosses ? Voici l'image dans la tête de l'émetteur :
Je construis une idée dans ma tête à partir du message que je reçois de mon interlocuteur.
Le message que je reçois est teinté par ma culture, mes expériences et tous les autres aspects de mon identité: genre, âge, profession, etc. Exemple: Un Québécois entend son collègue Français lui demander : Hé! Tu veux voir une photo de mes gosses ? Voici l'image dans la tête du récepteur:
Qu'est-ce que le choc culturel ?
Le choc culturel est « une expérience émotionnelle et intellectuelle provenant du heurt avec la culture de l’autre qui peut occasionner une réaction de dépaysement, parfois de frustration, d’anxiété ou de rejet. »
EXERCICE RÉFLEXIF
Source : Cohen-Emerique, 2015 tiré de Gaudet (2020)
- Qui vit un choc culturel ?- Comment savoir qu’on vit un choc culturel ?- Quelles sont les étapes d'un choc culturel ?- Comment surmonter un choc culturel ?
Témoignage de Lhoussaine Dadaoui, professeur à Garneau
Dans votre journal de bord, faites l'exercice de réflexion suivant :
- Avez-vous déjà vécu un choc culturel ?
- Quelle était la cause ? Dans quel contexte ?
- Quelles émotions avez-vous ressenties ? Comment avez-vous réagit ?
- Quelles stratégies avez-vous utilisées pour vous adapter à la situation ?
Qui vit un choc culturel ? Le choc culturel est vécu par toute personne placée en situation interculturelle : séjour à l’étranger, migration, interaction avec une personne d’une autre culture que la sienne, etc. Diverses émotions peuvent aussi être ressenties lors de contacts indirects via l’actualité, la lecture, les fictions, les documentaires, etc. Comment savoir qu’on vit un choc culturel ? Un choc culturel fait partie du processus d’adaptation qui permet de s’intégrer à un groupe culturel, d’interagir avec une personne d’une autre culture et d’ouvrir le dialogue menant à la compréhension et à la négociation. Plusieurs réactions au choc culturel s’apparentent à un stress intense; c’est pourquoi les émotions et le moral des personnes qui le vivent sont en montagne russe. Le choc culturel est souvent vécu de manière inconsciente. Bien qu’il soit souvent accompagné d’une réaction ethnocentrique, ou d’un rejet de l’Autre, ces attitudes et comportements sont généralement temporaires. C’est pourquoi il est important, en contexte interculturel, de demeurer vigilant : « S’arrêter au choc culturel, cela veut dire se méfier de ses premières impressions, les considérer comme provisoires, surtout lorsque l’écart culturel entre les personnes en présence est important ». (Cohen-Émérique 1993, p.77) Les étapes du choc culturel On identifie généralement quatre étapes à ce processus. Le temps entre chacune des étapes varie d’une personne à l’autre et selon les situations vécues :
- La lune de miel (curiosité, fascination, enthousiasme)
- Le choc (confusion, frustration, contrariété)
- L’ajustement (décentration, stratégie d’adaptation)
- Intégration/aisance biculturelle/compétence interculturelle
Les obstacles à la communication interculturelle
En contexte interculturel, plusieurs obstacles peuvent nuire au dialogue, freiner le développement d’un lien de confiance et entraver la recherche de solutions. Nous avons vu déjà que la culture peut déformer notre perception de la réalité, à cause de biais inconscients ou d'une attitude ethnocentrique. Plusieurs autres attitudes et comportements peuvent contribuer à dévaloriser, à dénigrer et à exclure l’Autre. En voici quelques-uns. Nous vous invitons à lire d’abord les brèves définitions puis à visionner ensuite les courtes capsules vidéo en lien avec chacun des obstacles.
Définitions et capsules vidéo portant sur les mécanismes d’exclusion
EXERCICES
Mécanismes qui simplifient et dévalorisent la différence Stéréotype : image mentale simplifiée, caricaturale et généralement dévalorisante qui est véhiculée au sein d’une collective à l’endroit de certaines personnes, en fonction de leur groupe d’appartenance. Préjugé : idée préconçue, favorable ou défavorable, souvent fondée sur un stéréotype, que l’on se fait d’une personne, d’un groupe ou d’une situation. Le préjugé défavorable pousse un individu à la méfiance et au rejet (inspiré de Gaudet 2020). Stéréotypes et les préjugé - https://www.monamiblanc.org/ Micro-agression : paroles, attitudes ou comportements, plus ou moins intentionnels, parfois même inconscients, qui dévalorisent la personne et affectent son intégrité. Souvent sous forme de commentaires désobligeants, hostiles ou qui réfèrent à des stéréotypes. Micro-agression - https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/51523/les-micro-agressions Appropriation culturelle : emprunt irrespectueux et souvent hors contexte d’éléments culturels d’un groupe opprimé par un groupe dominant (ou colonisateur). L’utilisation des référents culturels peut servir les intérêts (commerciaux, artistiques, publicitaires, etc. ) d’individus appartenant au groupe dominant, sans égard aux visions, aux volontés ou aux besoins du groupe dominé. Cette pratique contribue également à stigmatiser, ridiculiser et dévaloriser les référents culturels d’un groupe minorisé. Appropriation culturelle - https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/51516/l-appropriation-culturelle Mécanismes qui excluent et briment les droits Discrimination : traitement différent d’une personne en raison de ses caractéristiques personnelles ou culturelles qui l’empêche d’exercer ses droits (CDPDJ). Racisme : ensemble des idéologies, des discours et des pratiques discriminatoires qui se fondent sur la prétention d’un groupe à sa supériorité naturelle (ou « raciale »), ou encore culturelle, pour justifier ses privilèges et sa domination sur les autres groupes (adaptée de Tessier, 1995). Racisme systémique - https://enclasse.telequebec.tv/contenu/le-racisme-systemique/519
Dans votre journal de bord, faites les exercices de réflexion suivants : Exercice : À partir de la vidéo Où sont tes plumes ? de Mélanie Lumsden (Wapikoni mobile), trouvez des exemples aux mécanismes d’exclusion présentés plus haut. Wapikoni - Où sont tes plumes ? - http://www.wapikoni.ca/films/ou-sont-tes-plumes (4,53 minutes) Exercice : À partir du documentaire Briser le code de Nicolas Houde-Sauvé, illustrez chacun des mécanismes d’exclusion exposés ci-dessus. Expliquez ensuite pourquoi il est difficile, pour les personnes qui les subissent, de dénoncer ces situations. Briser le code - https://briserlecode.telequebec.tv/#:~:text=Briser%20le%20code%20est%20un,code%20pour%20ne%20pas%20d%C3%A9ranger%E2%80%A6 (52 minutes)
Selon Hall, une réaction doit être considérée dans sa globalité, «[…] car pour en donner une interprétation correcte, il faut la rattacher à un contexte. Il faut expliquer le système dans son ensemble, sinon il est difficile de comprendre le comportement de [l’être humain] » (Hall 1976 : 67). La clé pour y arriver repose sur l’expérience ! Pour découvrir la dimension cachée de la culture et saisir toutes les nuances que comportent les attitudes et les comportements de l’Autre, l’idéal est de vivre une expérience d’immersion culturelle de plusieurs mois. À défaut de pouvoir vivre de telles expériences – que l’on vous souhaite si ce n’est pas déjà fait – la communication interculturelle propose une démarche à suivre pour favoriser la compréhension mutuelle et ouvrir le dialogue.
Démarche à suivre pour ouvrir le dialogue
Principes de base
Étapes à suivre
Principes de base à respecter pour ouvrir le dialogue 1- Faire un premier pas vers soi Le développement de compétences interculturelles exige un prérequis : avoir une volonté réelle et sincère de découvrir l’Autre, de voir le monde à travers d’autres « lunettes culturelles » que les siennes. Dans une telle démarche, le premier pas doit d’abord être fait vers soi. Pour comprendre l’Autre, il est important de bien se connaître et de savoir à travers quelles « lunettes » on regarde le monde. C’est en ce sens que vous avez été invité.es à réfléchir à votre culture dans la section sur ce thème. Il est aussi essentiel d’être conscient de son degré d’ouverture et de sa sensibilité à l’Autre. En situation interculturelle, il peut être utile de prendre conscience de votre stade de sensibilité ainsi que celui de votre interlocuteur. Le lien ci-dessous vous conduit vers le modèle de développement de la sensibilité interculturelle développé par Milton Bennett, illustré et adapté par AFS Canada. Lien vers le guide de AFS : https://www.afscanada.org/guide-pour-reussir-son-experience-interculturelle/ [section Les étapes qui mènent à la compétence interculturelle]. 2- Faire preuve de relativisme culturel Le relativisme culturel est une attitude d’ouverture et de curiosité face à la diversité. En s’abstenant de juger l’Autre, la personne part du principe que tout comportement ou attitude n’a de sens que dans un contexte particulier. Pour comprendre l’Autre, il faut donc apprendre à connaître sa culture ainsi que la logique qui sous-tend ses normes, ses valeurs et ses façons de faire. Faire preuve de relativisme n’implique pas d’être en accord avec les idées ou les façons de faire de l’Autre, mais de comprendre son point de vue pour ouvrir le dialogue à partir d’un regard plus juste et nuancé de la situation. *Le relativisme aide à surmonter le choc culturel. Il est la clé vers la compréhension mutuelle et la recherche de solutions. Pour vous aider, consultez le Portail du Gouvernement du Canada. « Ce portail d’information fournit des aperçus culturels uniques sur plus de 100 pays et régions. Ces aperçus se concentrent sur des questions interculturelles clés, et ce, d’un point de vue canadien et local ». 3 - Prendre conscience des inégalités et des enjeux sociohistoriques Au-delà des questions identitaires et des incompréhensions culturelles, les relations interculturelles nous renvoient aussi aux chocs des cultures, aux inégalités entre les groupes et aux blessures provoquées par certains événements historiques. Par exemple, au Québec, les relations entre les Autochtones et les allochtones sont profondément marquées par le génocide culturel qu’ont subi les Premiers Peuples et les rapports de domination. S’ouvrir à l’Autre, c’est aussi reconnaître ces inégalités et ces rapports de pouvoir. Et mieux se connaître, pour les personnes blanches qui ne sont pas issues de groupes « racisés » ou stigmatisés, c’est reconnaître « le privilège Blanc » pour éviter de reproduire des comportements paternalistes ou dominateurs. Le Privilège Blanc – https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/51520/le-privilege-blanc
Quatre étapes à suivre pour aller à la rencontre de l’Autre Nous proposons ici quatre étapes pour comprendre et interagir de manière constructive en contexte interculturel. 1. Être sensible aux signes révélateurs d’un choc culturel :
- Questions à se poser : Quelles sont les émotions ressenties ? Comment réagissent les personnes impliquées dans la situation ?
- Questions à se poser : Qu’est-ce qui fait réagir ? Qu’est-ce qui provoque un malentendu ou un choc culturel
- Questions à se poser : Quels sont les éléments culturels, identitaires et sociétaux qui peuvent expliquer les attitudes et les comportements des personnes ? Pourquoi agissent-elles de cette manière ? Pourquoi semblent-elles avoir de la difficulté à se comprendre ? Quels sont les obstacles à la communication présents dans la situation ? Et plus globalement, quels sont les enjeux sociaux qui poussent les acteurs à agir ou réagir ainsi ? Qu’est-ce que chacun peut avoir à gagner ou à perdre ? Quels sont les besoins de chacun ?
- Questions à se poser : Comment peut-on répondre aux besoins de chacun des acteurs ? Comment peut-on reconnaître et valoriser les pratiques culturelles de chacun d’eux ? Est-ce que la solution proposée tient compte du point de vue de tous les acteurs en présence ? Est-ce qu’elle repose sur des valeurs de respect et de réciprocité ? Comment serait-il possible de prévenir une telle situation ?
Incident - Un stage au Maroc
Incident - Un étudiant innu
Incident - Un étudiant d'origine sénégalaise
Faites l'expérience
L'approche par incident critique
L’approche par incident critique vise à amener la personne apprenante à réfléchir et à objectiver des situations concrètes susceptibles de se produire en contexte interculturel, et ce, afin d’ouvrir le dialogue. Dans un premier temps, la personne est invitée à analyser un problème complexe en se décentrant de sa propre culture pour identifier et comprendre les principaux enjeux du point de vue des acteurs impliqués. Dans un deuxième temps, la participante ou le participant doit proposer des pistes de solution permettant de résoudre le problème en faisant preuve de jugement et d’impartialité. **Avant d'expérimenter les incidents critiques, nous invitons les participant.es à consulter la section 7 du module 3 au besoin (La communication interculturelle – Démarche pour ouvrir le dialogue).
Incident critique - Un stage au Maroc
1
Présentation de l'incident
2
Réflexion sur l'incident
4
Réflexion sur les pistes de solutions
5
Les pistes de solutions des experts
3
Analyse de l'incident par les experts
Incident critique - Un stage au Maroc Mi-mai, à Meknès, ville impériale du Maroc. Audrey et Marianne sont en stage interculturel depuis deux semaines. Elles ont chaud, très chaud. Ayant aperçu, la veille, une piscine publique non loin de la maison où Audrey est logée, elles décident d’aller faire trempette. Aïsha, qui accueille Audrey, a été invitée par texto. Elle tarde à répondre, puis prétexte un petit malaise pour ne pas les accompagner. Une fois sur place, les deux Québécoises réalisent qu’à la piscine, il n’y a que des hommes, des plus jeunes, des plus âgés. Qu’à cela ne tienne, elles ont chaud, enfilent leur maillot dans les vestiaires et se présentent près de l’eau. Sans trop porter attention, les filles réalisent que les hommes les regardent fixement. Leurs maillots suscitent des regards insistants. Elles plongent dans l’eau qui est à peine fraiche. Peu à peu, les hommes plongent eux aussi. Plusieurs se rapprochent, certains les frôlent. Après quinze minutes, un attroupement se produit autour des deux stagiaires, à tel point que les gardiens de piscine leur demandent de quitter. En soirée, Audrey entend Aïcha échanger avec son père en arabe. Le ton semble tendu. Inquiète, elle communique avec son professeur-accompagnateur, qui a déjà été mis au fait de l’incident.
Dans votre journal de bord, essayez d'analyser la situation en vous attardant aux enjeux sociohistoriques ainsi qu'au point de vue des différents acteurs.
Dans votre journal de bord, notez les clés qui pourraient, selon vous, dénouer ou prévenir cet incident.
Incident critique - Un étudiant innu
1
Présentation de l'incident
2
Réflexion sur l'incident
4
Réflexion sur les piste de solutions
5
Les pistes de solutions des experts
3
Analyse de l'incident par les experts
MISE EN SITUATION Uapush est un étudiant innu de 22 ans originaire de la communauté de Pessamit (Côte-Nord). Il est motivé et déterminé à réussir! Bien qu’il soit discret en classe et échange peu avec les autres étudiant-es, Uapush pose régulièrement des questions et discute avec Pierre, son professeur, avant et après la classe. C’est lors de l’un de ces échanges que Pierre encourage Uapush à partager ses réflexions, qu’il juge fort intéressantes, avec ses collègues de classe. Depuis quelque temps, Pierre a remarqué que Uapush s’implique moins dans ses travaux, ne semble pas avoir développé de liens avec ses collègues de classe, et s’absente de plus en plus. Après l’avoir questionné, il lui confie qu'il vit des difficultés familiales. L’étudiant nomme se sentir isolé de sa famille et il songe à abandonner le cégep pour retourner auprès des siens. Pierre lui conseille alors de consulter un intervenant aux services psychosociaux du cégep. Deux semaines plus tard, Pierre constate que Uapush n’est pas allé consulter et que la situation se détériore.
Dans votre journal de bord, essayez d'analyser la situation en vous attardant aux enjeux sociohistoriques ainsi qu'au point de vue des différents acteurs.
Dans votre journal de bord, notez les clés qui pourraient, selon vous, dénouer ou prévenir cet incident.
Incident critique - Un étudiant d'origine sénégalaise
1
Présentation de l'incident
2
Réflexion sur l'incident
4
Réflexion sur les piste de solutions
3
Analyse de l'incident par les experts
5
Les pistes de solutions des experts
Incident critique – Un travail en équipe avec un étudiant d’origine sénégalaise Seydou est un étudiant d’origine sénégalaise qui a immigré au Québec avec ses parents lorsqu’il avait 13 ans. Il a un bon réseau social, fait de la musique et aime écrire – surtout des paroles de chansons. Motivé et enjoué par un projet à réaliser dans le cadre d’un travail d’équipe pour un cours de littérature, Seydou avait suggéré à ses collègues d’explorer des œuvres d’auteurs africains. Il leur avait même proposé de leur prêter des livres. Seydou arrive parfois en retard aux rencontres d’équipe. Lors d’une réunion où il n’était pas encore arrivé, ses coéquipiers ont pris une décision sans le consulter, mettant ainsi de côté l’idée d’explorer des œuvres d’auteurs africains. Déçu, Seydou a l’impression que ses collègues ne semblent pas lui faire confiance. Après cet incident, il se sent de moins en moins motivé et impliqué dans le projet. Après quelques semaines, Seydou cesse d’assister aux rencontres d’équipe. L’équipe en informe la professeure. Lorsque celle-ci questionne Seydou, il lui répond de ne pas s’en faire et qu’il va réaliser le travail seul.
Dans votre journal de bord, essayez d'analyser la situation en vous attardant aux enjeux sociohistoriques ainsi qu'au point de vue des différents acteurs.
Dans votre journal de bord, notez les clés qui pourraient, selon vous, dénouer ou prévenir cet incident.
Lorsque vous avez terminé l’exercice, écoutez les experts vous partager de leurs clés
5. Les clés de la communication interculturelle
Exercice
Dans votre journal, répondez aux questions suivantes à la lumière de vos apprentissages :
- 1. Que retenez-vous de cette formation ? Qu’avez-vous appris ?
- 2. Quels sont les comportements et les attitudes à privilégier en contexte interculturel ?
- 3. Quels sont les comportements et les attitudes que vous mettiez déjà en pratique ?
- 4. Quels sont les comportements et les attitudes que vous pourriez développer davantage ?
Écoutez d'abord ces quelques témoignages de personnes immigrantes.
6. Soyez les héros de vos incidents critiques !
Que ce soit lors de voyages, au cégep - avec des collègues ou des étudiantes et des étudiants - ou dans votre vie personnelle, vous rencontrerez inévitablement des situations qui provoquent un choc culturel. Comment mieux comprendre la situation et ouvrir le dialogue ? Comment réagir positivement ? Maintenant que vous avez expérimenté les incidents critiques, nous vous invitons à tenter de dénouer vos propres incidents, à l'aide des deux exercices proposés.
EXERCICE 1
EXERCICES 2
Au besoin, n’hésitez pas à retourner à la section 3 - La démarche à suivre pour ouvrir le dialogue.
EXERCICE 1 - RETOUR DANS LE PASSÉ Dans votre journal de bord, notez vos réflexions en lien avec les éléments ci-dessous Réfléchissez à un incident critique que vous avez déjà vécu. Décrivez la situation en précisant le contexte, les personnes impliquées ainsi que les actions et réactions des gens. ÉTAPE 1 - Être sensible aux signes révélateurs d’un choc culturel Essayez de vous souvenir des émotions que vous avez ressenties dans cette situation. Quelles sont-elles ? Quelles étaient, selon vous, les émotions ressenties par les autres personnes impliquées ? Pouvez-vous faire des liens entre ces réactions et les signes d’un choc culturel ? ÉTAPE 2 - Identifier les attitudes et comportements en cause Quels étaient les éléments en cause dans la situation (enjeux, vision du monde, codes culturels...) ? Qu’est-ce qui vous a fait réagir ou a fait réagir votre interlocuteur ? ÉTAPE 3 - Analyser la situation à partir du point de vue de chacun des acteurs En vous inspirant de nos experts et des clés de la communication interculturelle, analysez la situation de la manière la plus objective possible en tenant compte du point de vue des différents acteurs. ÉTAPE 4 - Proposer des pistes de solutions Si vous vous retrouviez aujourd’hui dans cette situation, votre réaction serait-elle différente ? Pourquoi ? Quelles clés de la communication interculturelle vous seraient utiles ?
EXERCICE 2 - EXERCEZ VOS SUPER POUVOIRS Dans votre journal de bord, notez vos réflexions en lien avec les éléments ci-dessous La prochaine fois que vous pensez vivre un incident critique, nous vous invitons à utiliser les « super pouvoirs » que vous avez développés en suivant la même démarche. ÉTAPE 1 - Être sensible aux signes révélateurs d’un choc culturel Quelles sont les émotions que vous ressentez face à la situation ? Quelles sont les émotions que vous pouvez identifier chez l’Autre ? Qu’est-ce qui vous fait dire que vous êtes en situation de choc culturel ? ÉTAPE 2 - Identifier les attitudes et comportements en cause : À partir de l’observation de la situation, essayez d’identifier les éléments en cause (enjeux, vision du monde, codes culturels, contexte historique, etc.). Qu’est-ce qui vous a fait réagir ? Qu’est-ce qui fait réagir votre ou vos interlocuteur.s ? ÉTAPE 3 - Analyser la situation à partir du point de vue de chacun des acteurs : En vous inspirant de nos experts et des clés de la communication interculturelle, analysez la situation de la manière la plus objective possible en tenant compte du point de vue des différents acteurs. N’oubliez pas de changer votre paire de lunettes ! Pour y arriver, n’hésitez pas à recourir à des experts ! Qui pourrait vous aider ? Qui pourrait vous amener à relativiser votre point de vue ? Est-ce que des lectures ou des documentaires pourraient alimenter votre réflexion ? ÉTAPE 4 - Proposer des pistes de solutions Quelles clés de la communication interculturelle vous seraient utiles pour trouver une solution ? Cette solution répond-elle adéquatement, et de manière équitable, aux besoins des personnes impliquées dans l’incident ? Comment doit se prendre la décision ? Qui sont les personnes /instances qui doivent être impliquées dans la prise de décision ? Est-ce que vous connaissez des "experts“ qui pourraient vous guider ou servir de médiateurs.trices. ? Dans une perspective à plus long terme, comment pourriez-vous contribuer à prévenir une telle situation ? Y a-t-il des changements à faire dans votre attitude, ou plus globalement, dans l’organisation et le fonctionnement de votre milieu de vie/ travail.
7. Pour aller plus loin...
Quelques références documentaires et audiovisuelles
1. Les relations et la communication interculturelles
2. Les Premiers Peuples
3. L’immigration et les étudiants étrangers
4. Les stages à l’étranger
5. Recherches au collégial sur la diversité culturelle
6. Oeuvres littéraires et cinématographiques
Sur les Relations et la communication interculturelles Documents de lecture sur la communication et les relations interculturelles
- ST-DENIS, K. « Chapitre 6 – Le relativisme culturel et les bases de la communication interculturelle » dans Culture et diversité. Initiation à l’anthropologie. Les éditions CEC, 2006, Anjou, 93 à 107. – Bibliothèque du Cégep Garneau
- GAUDET, É. « Chapitres 6 – Les relations interculturelles » dans Relations interculturelles. Comprendre pour mieux agir. 4 édition, Éd. Modulo, Montréal, 2020, p.118 à 137. – Bibliothèque du Cégep Garneau
- MELLOUKI, M. « Chapitre 3 – Temps, espace et communication interculturelle » dans La rencontre. Essai sur la communication et l’éducation en milieu interculturel, PUL, Québec, 2004, p.71 à 110. – Bibliothèque du Cégep Garneau
- Université Laval, Choc culturel et adapation – Bureau de la vie étudiante
- Bourassa-Dansereau et Montgomery (dir.), Mobilités internationales et intervention interculturelle, 2017, Montréal, Québec: PUQ
- Documentaire Briser le code – En ligne
- Capsules de Briser le code sur les mécanismes d’exclusion : biais inconscients, appropriation culturelle, micro-agressions, etc. – En ligne
- Moi, j’ai un ami Blanc ! Capsules humoristiques sur les stéréotypes et les mécanismes d’exclusion – En ligne
- Montre-moi tes couleurs. Projet de Motivaction jeunesse avec la participation d’étudiants du Cégep Garneau.
- Capsule sur le racisme systémique - Radio-Canada
- ONF – Section sur la diversité culturelle
- Pour mon fils, mon silence est impossible – Radio-Canada
Les Premiers Peuples Documents de lecture sur les Premiers Peuples
- LEPAGE, P. Mythes et réalités sur les peuples autochtones. Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) et Institut Tshakapesh, Montréal, 2019, 176 p. – En ligne.
- Guide pédagogique Wapikoni : Introduction à la diversité des cultures autochtones au Canada. Wapikoni, 2019 – En ligne
- GAUDET, É. « Chapitre 3 : Les Autochtones », dans Relations interculturelles. Comprendre pour mieux agir. 4e édition, Éd. Modulo, Montréal, 2020, p.52 à 78. – Bibliothèque du cégep Garneau
- AMNISTIE INTERNATIONALE et MIKANA. « Tu n’as pas l’air autochtone ! » et autres préjugés. Livret produit par Amnistie Internationale – En ligne.
- RÉSEAU DE LA COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE À MONTRÉAL. Trousse d’outils pour les alliées aux luttes autochtones. – En ligne.
- Guide institutionnel du Cégep de Baie-Comeau. Pour favoriser la réussite éducative des étudiantes et des étudiants du Cégep de Baie-Comeau. – En ligne
- Briser le code : Autochtones 102, Télé-Québec – En ligne
- Québékoisie de Mélanie Carrier et Olivier Higgins – Disponible à la bibliothèque (Section de Curio.Ca)
- GILL, M-A. Laissez-nous raconter : L’histoire crochie, Ici Première de Radio-Canada. – En ligne.
Sur l’immigration et les étudiants étrangers Documents de lecture sur l’immigration et les étudiants étrangers
- GAUDET, É. « Chapitre 1. Les modalités et les enjeux de l’immigration » dans Relations interculturelles. Comprendre pour mieux agir. 4 édition, Éd. Modulo, Montréal, 2020, p.1 à 28
- GAUDET, É. « Chapitre 4 : L’intégration des immigrants à la société d’accueil », dans Relations interculturelles. Comprendre pour mieux agir. 4 édition, Éd. Modulo, Montréal, 2020, p.80 à 99
- Cégep Garneau - Guide pratique pour les étudiants internationaux. – En ligne
- Bagages de Paul Tom (2017) – Disponible via le site de la bibliothèque
- Choc migratoire de UnisTV – En ligne sur tout.tv
- Déraciné, Émission dochumanité – En ligne sur tout.tv
Sur les stages à l’étranger Documents de lecture sur les stages à l’étranger
- Gouvernement du Canada, Bon voyage, mais... Renseignements indispensables pour les voyageurs canadiens – Guide disponible en version PDF en ligne
- Gouvernement du Canada. Voyager au féminin. La sécurité avant tout. – En ligne
- BOUTET-LANOUETTE, M. et JOBIN-LAWLER, J. Petit guide de préparation au voyage, 2014. – En ligne
- LORD, A. Prendre le temps d’atterrir, Plan Nagua, Québec, 2005 – Bibliothèque du Cégep.
- Gouvernement du Canada. Atténuer le choc culturel. – En ligne
- « Qu’est-ce que le tourisme durable ? », Double sens : Voyage & partage – En ligne
- Gouvernement du Canada - Aperçus culturels
- Je pars en voyage – Site pour préparer un voyage – Disponible en ligne
- Gouvernement du Canada. Informations pour les voyageurs à l’étrangers et sur la situation de différents pays – Disponible en ligne
- AFS Canada. Guide pour réussir son expérience interculturelle – Disponible en ligne
Recherches au collégial sur les relations interculturelles et l’inclusion des étudiants issus de minorités ethniques Recherches sur la pédagogie inclusive
- IRIPI. Actes de colloque : Pratiques inclusives en contexte de diversité dans les milieux d’enseignement. – En ligne
- IRIPI. Actes de colloques : Comment aborder les sujets sensibles en classe. – En ligne
- POTVIN, M. L’éducation antiraciste, inclusive et aux droits dans le développement des compétences professionnelles du personnel scolaire et des capabilités des élèves. Éthique en éducation et en formation, 2017, (3), 97-121. – En ligne
- Regroupement des centres d’amitié autochtones du RCAAQ Favoriser la persévérance et la réussite éducative des étudiants autochtones postsecondaires. 2020 – En ligne
- MARESCHAL, J. ET DENAULT, A-A. Persévérance et réussite scolaires des étudiants autochtones au collégial – Récits et pratiques liés à la sécurisation culturelle issus de cégeps de Québec et de Trois-Rivières. Cégep Garneau. 2020. – En ligne
- CAPRES (2018). Étudiants des Premiers Peuples en enseignement supérieur. - En ligne
- ROBERT-CAREAU, F. « Pour favoriser l’inclusion des étudiants autochtones », Pédagogie collégiale, 2019, vol 33, no.1 – En ligne
- DUFOUR, E. « La sécurisation culturelle des étudiants autochtones », Pédagogie collégiale, vol. 32, no.3 – En ligne
- LACHAPELLE, M. « La décolonisation : un projet d’éducation sociétal et d’enrichissement mutuel » Pédagogie collégiale, vol. 32, no.3 – En ligne
- THÉAGÈNE, M. L. L’adaptation à la diversité ethnoculturelle du corps professoral en milieu clinique dans le programme Soins infirmiers, Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke. 2015 – En ligne
- Loslier, S. La situation des étudiants québécois issus de l'immigration en stage professionnel : de la théorie au stage. Longueuil, Québec : Cégep Édouard-Montpetit. 2015. – En ligne
Œuvres littéraires et cinématographiques sur les minorités ethniques au Québec Œuvres littéraires sur des réalités autochtones
- FONTAINE, N. Shuni : ce que tu dois savoir Julie. Mémoire d’encrier, Montréal. 2019.
- KANAPÉ FONTAINE, N. et BÉCHARD, D. Kuei, je te salue : conversation sur le racisme. Écosociété. 2016.
- DUFOUR, E. « C’est le Québec qui est né dans mon pays ». Carnet de rencontres, d’Ani Kuni à Kiuna. Écosociété. 2021.
- LAFERRIÈRE, D. Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo. Mémoire d’encrier. 2015.
- THUY, K. À toi. Éditions Liana Levi. 2011.
- FARHOUD, A. Le bonheur a la queue glissante.Typo. 1998.
- MAZIGH, M. Du pain et du jasmin, Davide Roman. 2015.
- *Voir aussi les autres suggestions de lectures sur ce site.
8. Animer et organiser des ateliers de sensibilisation
Quelques idées pour vous guider
1. Rédiger vos propres incidents critiques
2. Activités préparatoires à toute forme de rencontre interculturelle
3. Activités à faire en classe
4. Activités pour sortir de la classe
5. Activités pour enrichir la formation professionnelle
RÉDIGER VOS PROPRES INCIDENTS CRITIQUES Comment rédiger un incident critique ? En vous basant sur des expériences réelles vécues en classe, en stage, en milieu de travail professionnel, ou encore, en sondant vos étudiants sur celles qu’ils ont vécues, formulez des incidents critiques pertinents pour développer la compétence interculturelle ou toute autre compétence de vos cours. Faites ensuite valider ces incidents par des experts de la communication interculturelle et de vécu lié aux cultures concernées. Comment résoudre l’incident ? Invitez des experts à analyser l’incident et à proposer des pistes de solutions. L’analyse peut être présentée de différentes manières : document écrit, capsules vidéo, enregistrement audio, ateliers (panel, conférence, table ronde...), etc. Comment identifier un expert ? Les gens issus des groupes culturels concernés sont les personnes les mieux placées pour analyser les situations. En plus d’apporter un regard juste et plus représentatif de la réalité, elles sont plus en mesure de présenter la complexité de la situation et d’apporter les nuances nécessaires à sa compréhension. Les personnes qui ont vécu une intégration culturelle au sein du groupe concerné ET qui ont reçu une formation sérieuse en communication interculturelle peuvent aussi apporter un éclairage pertinent sur votre incident.
ACTIVITES PRÉPARATOIRES À TOUTE FORME DE RENCONTRE INTERCULTURELLE Avant une rencontre interculturelle, quelle que soit sa forme, il est essentiel de sensibiliser les étudiantes et les étudiants aux réalités et pratiques culturelles et de leur apprendre à poser des questions ouvertes et exemptes de préjugés ou de biais inconscients. I - Acquérir des connaissances de base Avant toute rencontre, les étudiantes et les étudiants doivent avoir une base de connaissances du groupe culturel concerné par l’activité d’échange : sa culture, son histoire, les principaux enjeux socio-économiques ou politiques, etc. Cette sensibilisation peut se faire via un document de lecture, le visionnement d’un documentaire ou l’écoute d’un balado (voir section Pour aller plus loin pour quelques références). II - Savoir formuler des questions qui ouvrent le dialogue Poser des questions est généralement un signe de curiosité et d’ouverture à l’Autre. Mal formulées, elles peuvent créer des malaises, voire même rompre le dialogue. Voici quatre clés pour mettre votre interlocuteur à l’aise et en confiance : 1. La question doit vous permettre d’en apprendre davantage sur la culture de la personne ou du groupe concerné. Quelle est votre intention, qu’est-ce qui vous motive ? Que cherchez-vous à apprendre ? 2. La question doit être neutre et exempte de jugements de valeur. Votre question comporte-t-elle des idées préconçues ? Votre question comporte-t-elle des suggestions de réponse ? 3. Si vous faites référence à une situation ou à un phénomène particulier, assurez-vous que votre question repose sur des faits, et non des préjugés ou des stéréotypes. D’où proviennent les faits évoqués dans la question ? Les faits sont-ils représentatifs des réalités vécues par plusieurs membres de ce groupe ? 4. La question doit être formulée à partir de termes justes et respectueux du groupe culturel. D’où proviennent les termes choisis ? Quels sont les termes appréciés et reconnus par le groupe culturel ? III - Tenir compte de l’individu et de sa situation : - Chaque personne est unique, même si elle partage certaines valeurs et habitudes propres à un groupe donné. Apprenez à connaître votre interlocuteur tel qu’il se présente à vous. - Tous les individus ne sont pas nécessairement des « experts » de l’histoire et de la culture de leur groupe d’appartenance. Votre interlocuteur n’a donc pas réponse à tout. - Les questions peuvent provoquer beaucoup d’émotions, surtout lorsqu’il s’agit de sujets sensibles. Votre interlocuteur appréciera votre empathie !
ACTIVITÉS À FAIRE EN CLASSE Portfolio d’apprentissage - Développer des attitudes favorables à la communication interculturelle Misez sur le journal de bord afin d'inviter les étudiantes et les étudiants à construire un portfolio qui leur permettra de prendre conscience des différences culturelles et de développer leurs compétences interculturelles. * Pour vous guider dans la création du portfolio, vous pouvez consulter l’article de Sylvie Gervais (AQPC, automne 2020) - LIEN Entrevue avec une personne d’une autre culture L’entrevue pourrait porter sur la vision du monde de la personne, en lien avec une thématique du cours ou un aspect spécifique de la profession. Ex. : Vision de la maladie ou de la santé, rapport au territoire, connaissance de la nature ou de la biodiversité, notion de droit ou de gestion du conflit, approche avec la clientèle ou les bénéficiaires de service, relation d’aide, etc. *Voir les consignes plus haut pour guider la formulation des questions préparatoires à la rencontre et en faire la révision avec l’étudiante ou l'étudiant. Lecture ou film qui exposent des réalités interculturelles *Voir section 7 - Pour aller plus loin Recherche / Projet / Exercice adapté au contexte culturel Permettre aux étudiantes et aux étudiants d’explorer des aspects de leur propre culture ou d’un autre groupe culturel dans le cadre d’une activité pédagogique formative ou sommative. Il se pourrait que cela demande à la professeure ou au professeur une certaine souplesse pour adapter l’exercice tout en considérant les compétences visées.
ACTIVITÉS POUR SORTIR DE LA CLASSE Participer à un événement à saveur interculturelle, individuellement ou en groupe. Voici quelques exemples : Événement KWE ! à Québec Mundo carnaval Mois de l’histoire des Noirs Semaine d’action contre le racisme Semaine de la diversité à Garneau et dans la ville de Québec Visiter un lieu à caractère interculturel Visiter un lieu permet d’échanger avec des membres d’un autre groupe culturel et de développer le sens de l’observation. Ce genre de visite permet de dépayser un peu, de vivre parfois certaines émotions du choc culturel et d’apprendre autant sur l’autre que sur soi-même en prenant davantage conscience de sa culture ! Voici quelques exemples : Un quartier ethnique ou multiethnique Une épicerie, un restaurant ou un autre type de commerce (salon de coiffure par exemple) ethnique ou multiethnique Un lieu de culte Un organisme communautaire Faire une visite organisée pour découvrir la diversité ethnoculturelle de la ville de Montréal Exemple : Kaléidoscope **ATTENTION ! Vérifier si le cégep a déjà des contacts avec un organisme ou si d’autres professeurs sollicitent ses services avant de communiquer avec celui-ci. Les organismes communautaires n’ont pas toujours les ressources nécessaires pour répondre à de nombreuses demandes.
ACTIVITÉS POUR ENRICHIR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Rencontre avec une professionnelle ou un professionnel d’une autre culture Inviter une professionnelle ou un professionnel appartenant à un groupe culturel qui diffère du modèle québécois pour vous parler de la manière de pratiquer sa profession dans son pays d’origine et des adaptations qu’il ou elle a dû faire pour exercer cette profession au Québec, de sa vision générale de cette profession et de la relation professionnelle entre les collègues, etc.. Rencontre avec des personnes composant la clientèle ou étant bénéficiaires de service d’une autre culture Organiser des rencontres avec des personnes qui bénéficient ou ont déjà bénéficié des services professionnels pour lesquels les étudiants reçoivent une formation.
