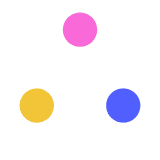
Module 4 Le système solaire
CHATEAU VERSAILLES
Created on February 8, 2021
More creations to inspire you
BASIL RESTAURANT PRESENTATION
Presentation
AC/DC
Presentation
ENGLISH IRREGULAR VERBS
Presentation
ALL THE THINGS
Presentation
SANTIAGOVR_EN
Presentation
WWII TIMELINE WITH REVIEW
Presentation
BLENDED LEARNING
Presentation
Transcript
L'ASTRONOMIE à VErSAILLES
Uranie et Melpomène© Château de Versailles, Dist. RMN / © Jean-Marc Manaï
AUTOFOrMATION À DISTANCE
La découverte du système solaire
bienvenue dans le module N°4
À l'issue, un quiz vous permettra d'évaluer vos connaissances
- Les planètes au début du XVIIe siècle
- Les grandes découvertes sous Louis XIV
- Les Princes et l'astronomie
- La planétologie à l'Observatoire depuis le XVIIIe siècle
BONNE FOrMATION !
Dans ce module nous aborderons :
Pour en savoir plus cliquez sur le mot en gras
Le mot planète est un adjectif, πλανήτης, planếtês, de l'expression planếtês astêr, qui désigne en grec ancien un « astre en mouvement » par rapport aux étoiles fixes constituant la sphère céleste. Étymologiquement, le terme s'applique donc à la fois au Soleil, à la Lune, ainsi qu'aux cinq "planètes" facilement visibles à l'œil nu, Mercure et Vénus, dans le crépuscule du soir ou du matin, et Mars, Jupiter et Saturne, visibles jusqu'à 180° de la direction du soleil.
SÉQUENCE 4La planétologie à l'Observatoire depuis le XVIIIe siècle
SÉQUENCE 1Les planètes au début du XVIIe siècle
FOCUSLouis XIV et la figure d'Apollon
REssources
QUIZ TESTModule 4
SÉQUENCE 3Les Princes et l'astronomie
Début
La découverte du système solaire
SÉQUENCE 2Les grandes découvertes sous Louis XIV
RESSOURCESPour aller plus loin
MODULE 4
la découverte du système solaire
SÉQUENCE 1Les planètes au début du XVIIe siècle
Au début du XVIIe siècle, les planètes sont toujours associées au Soleil et à la Lune, et ce en dépit de l’hypothèse de Copernic qui place le Soleil au centre du mouvement - un grand débat règne alors de savoir si la Terre elle-même est en mouvement autour du Soleil. Un grand astronome du Danemark, Tycho Brahe, multiplie alors les observations précises des mouvements planétaires, et le mathématicien allemand Kepler les utilisera pour établir la forme elliptique des mouvements autour du Soleil. De nouvelles tables et calendriers voient alors le jour et leur succès affirme la supériorité du modèle de Kepler : l’astronomie moderne est née. C’est avec la lunette de Galilée que vont se multiplier les observations de la Lune et des planètes, ouvrant la voie à la succession de découvertes par Cassini, Huygens et les astronomes de l’Académie royale.
© Wikipedia/Brian Brondel
Depuis l'Antiquité, le mouvement des cinq planètes - Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne - suscite une grande curiosité. Au contraire de la Lune et du Soleil, dont le parcours le long des constellations zodiacales est régulier et répétitif, celui des planètes est capricieux et provoque nombre d'interrogations. Chacune de ces planètes semble en effet, reculer et changer de sens et de parcours pendant plusieurs mois, le long de boucles ou de zig-zags assez différents d'une fois à l'autre. Ce mouvement est très difficile à modéliser dans le modèle géocentrique. Il trouve en revanche une explication très simple dans le système héliocentrique du fait du mouvement naturel de la Terre autour du Soleil.
Tycho Brahé par Jérémias Falk ” © Château de Versailles, Dist. RMN
À L'ORIGINE TYCHO BRAHE ET JOHANNES KEPLER
Tycho Brahe (1546-1601) vit dans les tourments de l'Europe de la fin du XVIe siècle et des guerres de religion. En août 1563, à 17 ans, Tycho observe la conjonction de Jupiter et Saturne et constate que la date de l'observation diffère de plusieurs jours de celle prédite par les éphémérides. Il dispose pourtant des Tables pruténiques qu'Erasmus Reinhold a calculées selon le système héliocentrique de Copernic. Cet écart entre la théorie et l’observation influence profondément le jeune astronome. Observateur infatigable, protégé de l'empereur du Danemark, Tycho Brahe construit son observatoire, Uraniborg, qu'il dote des instruments les plus précis jamais conçus.Il va accumuler près de 30 années d'observations précises de positions d'étoiles et du mouvement des planètes par rapport à elles.
Johannes Kepler © Château de Versailles, Dist. RMN
Les Tables rudolphines abandonnent définitivement le calcul d’éphémérides fondé sur la combinaison de périodes apparentes (déférent, épicycle, excentrique) des corps du Système solaire dans le système géocentrique de Ptolémée. Elles ouvrent la voie à l'astronomie moderne et ses lois mathématiques. Leur précision est démontrée de façon éclatante en 1631, trois ans après la mort de Kepler, quand le 7 novembre, conformément aux prédictions, l'astronome Pierre Gassendi est le premier à observer le passage de Mercure devant le soleil.
Les données de Tycho Brahe permettent à Johannes Kepler (1571-1630) de déterminer la figure elliptique des trajectoires des planètes. Le Soleil, placé à l'un des foyers de chacune des ellipses, assure le mouvement à l'aide d'une vertu motrice s'exerçant à distance, dont Kepler spécule l'existence, sans en découvrir la nature.
Mise en évidence des reliefs du terminateur lunaire par Galilée. Galileo Galilei, Sidereus nuncius, 1610.© Observatoire de Paris
Avec la découverte des phases de Vénus, il prouve au monde que la planète ne circule pas autour d'un point situé entre la Terre et le Soleil, comme on l'affirmait depuis l'Antiquité, mais passe bien derrière le Soleil en encerclant celui-ci, conformément au système héliocentrique de Copernic et à l'astronomie de Tycho Brahe et de Kepler.
LES DÉCOUVERTES DE GALILÉE
Avec la lunette, instrument d'observation conçu par l'opticien néerlandais Hans Lippershey, Galilée (1534-1642) va accumuler les preuves scientifiques du mouvement de la Terre et participer à un basculement majeur dans l'histoire des sciences : l'observation visuelle et l'expérimentation deviennent la base de toute théorie scientifique. Il découvre la nature stellaire de la Voie lactée, qu'il décrit comme un poudroiement d’étoiles impossible à dénombrer.Il observe les reliefs sur la lune qu'il attribue à des montagnes et des vallées.
Sidereus nuncius, magna... spectacula pandens... quae a Galileo Galileo,... sunt observata in lunae facie... apprime vero in quatuor planetis circa Jovis stellam disparibus intervallis... quos... novissime author depraehendit primus atque medicea sidera nuncupandos decrevit Galilei, Galileo (1564-1642). Auteur du texte© gallica.bnf.fr / BnF
La présence de lunes autour d'un autre corps que la Terre démontre qu'il est possible qu'un corps en mouvement puisse avoir une ou plusieurs lunes, et que le Système solaire peut comporter plusieurs centres. Le monde savant du XVIIe siècle se convainc alors peu à peu de la position centrale du Soleil dans le système copernicien.
Galilée découvre également, par projection de l’image du soleil sur un écran, l’existence des taches sombres. L’aspect et le déplacement régulier d'ouest en est lui permettent d'établir la période de rotation du soleil en 30 jours sur lui-même. La plus importante de ses observations, à laquelle il consacre une grande part de son Sidereus Nuncius, le Messager des étoiles, imprimé à Venise en 1610, est la découverte des quatre principaux satellites de Jupiter les 7, 8 et 10 janvier 1610. Il les nomme Stellae Medicae, "Etoiles Médicéennes", en hommage à ses protecteurs et mécènes, la famille des Médicis, Grands Ducs de Toscane.
Sommaire
Cette pendule extraordinaire comporte un globe terrestre gravé sur laiton argenté. Il tourne en 24 heures, le rayon du soleil indiquant l’endroit où à chaque moment le soleil se trouve à son zénith. Ses pôles s’élèvent et s’abaissent insensiblement pour tenir compte de la déclinaison du soleil et rendre les différentes longueurs du jour. Le cadran supérieur indique l’heure, le jour et le mois. Sur le planisphère, les planètes ont chacune leur mouvement propre et leur véritable excentricité. Une lune placée dans les rochers croît et décroît régulièrement.
Pendule dite “de la création du monde” 1754mécanisme de Roque, Joseph-Léonard (horloger)d'après Passemant, Claude-Siméon (horloger)boîtier de Germain, François-Thomas (bronzier) © Château de Versailles, Dist. RMN / © Jean-Marc Manaï
LA PENDULE DITE DE "LA CRÉATION DU MONDE"
la découverte du système solaire
SÉQUENCE 2Les grandes découvertes sous Louis XIV
1671
1724
1706
1684
1679
1676
1656
1667
1687
1691
1699
1683
1675
1659
1666
1655
DES DATES MAJEURES DES GRANDES DÉCOUVERTES SOUS LOUIS XIV
En France, la prestigieuse génération des savants de la première partie du XVIIe siècle, Descartes, Fermat, Pascal, Mersenne, Gassendi, s’est éteinte à la fin des années 1660 ; et c’est depuis l’extérieur des frontières du royaume que Colbert fera venir les deux plus grands astronomes européens pour refonder l’astronomie royale : Christian Huygens et Giovanni-Domenico Cassini.
Au XVIIe siècle, les rapports entre sciences et politique prennent des formes nouvelles dans l'espace européen. Les savants sont présents aux côtés du Prince dont ils illustrent la magnificence. Le pouvoir confère une protection et s'approprie, en retour, le prestige symbolique des découvertes.En 1666, Louis XIV et Colbert fondent l’Observatoire de Paris et l'Académie royale des sciences, qui tient sa première séance le 22 décembre 1666. Les deux créations sont liées, l'Observatoire étant alors destiné à servir de centre de travail pour les académiciens (salles des séances, laboratoires) aussi bien qu'à abriter les instruments pour les observations astronomiques, utiles à la mesure des longitudes et à la géographie.
Mais c’est également dans le domaine de la conception et du perfectionnement des horloges, à l’aide de mécanismes de son invention, indispensables à la mesure du temps pour la détermination des longitudes, que Christian Huygens acquiert un prestige dans toute l’Europe de la fin du XVIIe siècle. Il publie à Paris, en 1673, son ouvrge Horologium Oscillatorium. Il repart en Hollande en 1681 à la suite d’une maladie. La révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV l’empêche de revenir en France et il meurt en 1685.
Le père de Christiaan Huygens, Constantijn, est le secrétaire particulier du Prince d’Orange. Il est un familier des savants, artistes et médecins qui gravitent autour du Prince, et correspond avec Descartes et Mersenne, et il posséde un laboratoire scientifique. Christian Huygens étudie les ouvrages de Galilée, fait plusieurs séjours à Paris entre 1655 et 1664 au cours desquels il rencontre Gassendi, Pascal et Fermat, puis Colbert. Il construit dans le laboratoire familial à La Haye, une séries de télescopes. À l’aide de l’un d’entre eux, une lunette à très longue focale, il découvre en 1655 un satellite à la planète Saturne, qu’il nomme Titan. Il se convainc également que les satellites étranges observés par Galilée, Gassendi, Riccioli, sont en fait un anneau encerclant la planète, dont il découvre ainsi l’existence. Il annonce ces découvertes en 1659 dans son ouvrage Systema Saturnium.
Christiaan Huygens Etablissement de l'Académie des sciencesHenri Testelin 1673© Château de Versailles, Dist. RMN / © Jean-Marc Manaï
LES GRANDES DÉCOUVERTES DE CHRISTIAAN HUYGENS
Les figures ci-dessous sont extraites de l'ouvrage Systema Saturnium, publié par Christiaan Huygens en 1659. À gauche, les différents aspects de l’anneau de Saturne au télescope, avant la publication de la découverte de l’anneau par Huygens en 1659.À droite, l'explication donnée par Huygens de l'aspect d'un anneau encerclant la planète et vue sous différents angles selon la saison et la position de Saturne autour du Soleil. Tous les 14 ans et demi les anneaux disparaissent quand la Terre se trouve dans leur plan.
Les recherches sur Titan à l'Observatoire de Paris se poursuivent au XXIe siècle avec les données de la Mission Cassini-Huygens.
© Gallica - BNF Observatoire de Paris
LA DÉCOUVERTE DE TITAN, PREMIÈRE LUNE DE SATURNE
Le Triomphe de Saturne évoque les deux nouveaux satellites découvert par Cassini : Japet en 1671, et Rhéa l’année suivante, grâce à ses observations menées à l'Observatoire de Paris. Comme vu précédemment, Huygens avait découvert Titan en 1655. En 1684, il découvre encore deux satellites, Téthys et Dioné. Cassini propose de nommer tous les satellites de Saturne « Étoiles ludoviciennes » en l'honneur de Louis XIV.
À Versailles, ces découvertes scientifiques font leur chemin et influencent le peintre Noël Coypel. Ces deux tableaux sont organisés de la même façon : en arrière-plan, la divinité sur son char, tirée par des aigles pour Jupiter, et par des dragons dans le cas de Saturne. Au premier plan, figure une femme représentation allégorique de la planète. Elle est accompagnée de putti, reliés par une guirlande. Au nombre de quatre sur le tableau de Jupiter, et de trois pour Saturne, ils symbolisent les satellites récemment découverts autour des deux planètes.
Le triomphe de Saturne sur son char tiré par des dragons, 1672, Nöel Coypel© RMN-GP (Château de Versailles) / © Michèle Bellot
Le char de jupiter entre la Justice et la Piété, vers 1671 , Noël Coypel© Château de Versailles, Dist. RMN / © Christophe Fouin
Bibliothèque numérique - Observatoire de Paris
Visite 360° de la salle Cassini
À son arrivée à Paris en 1669, alors qu'il est logé au Louvre, Jean-Dominique Cassini trouve l’édifice de l'Observatoire élevé à hauteur du premier étage. Il critique le projet de Claude Perrault, qui va être modifié selon ses indications : suppression d’une des trois tours octogonales, réduction de moitié du grand escalier en U (qui reste imposant avec ses 156 marches) et aménagement d'une grande salle pour la méridienne au premier étage.
(Cassini I : Notes manuscrites à l’Observatoire, à propos de son arrivée à Paris).
Jean-Dominique Cassini. Anonyme© Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais
"Quand il n'y avait encore aucun endroit logeable dans l'observatoire, je fis premièrement les observations partie aux Galeries du Louvre, où M. Colbert avait fait accommoder à mon usage un appartement par le soin de M. Perrault, contrôleur des bâtiments du Roy, partie au jardin de la bibliothèque du Roy où était un grand quart de cercle et vis-à-vis un cadran à soleil, le plus grand et le plus exact qu'on eût vu à Paris, tracé par M. Buot, orné de très belles peintures par Jean Cotelle, et une méridienne, tracée sur une bande de cuivre enchâssée dans une table de pierre et vérifiée par M. Picard. L'aiguille aimantée n'en déclinait pas alors sensiblement. C'est dommage qu'elle ait depuis été déplacée par le jardinier”
LES GRANDES DÉCOUVERTES DE CASSINI
Histoptique, une alliance entre l'histoire et l'optique
la grande carte de la lune de J. Dom. CassiniGravure sur cuivre légendée par Cassini IV, 1788Observatoire de Paris
La carte de la lune
Si les premières lunettes permettant l'observation du ciel sont mentionnées dès le XVIe siècle, le XVIIe siècle et les progrès dans le domaine de l'optique marquent un tournant pour l'astronomie. Cassini I, avant son arrivée en France avait déjà, avec une lentille simple de quelques centimètres de diamètre, observé les durées de rotation de Jupiter, Mars et Vénus. Mais pour aller plus loin dans l'observation du ciel, des objectifs plus importants avec une longueur focale plus grande étaient nécessaires.
Vignette représentant l'observatoire et les différents moyens d'observations de l'époque. Tirée des Theses mathematicae de optica … / Jacques Cassini (Cassini II) - Parisiis, 1691 - p. de titre. 1290.
Les lunettes sans tuyau
Observations nouvelles de M. Cassini, touchant le globe et l'anneau de Saturne - Journal des Sçavans pour l'année 1677 - p. 33. - Observatoire de Paris
Dans son Systema Saturnium, publié en 1659, Christian Huygens démontre que Saturne est entourée d'un anneau. En 1672, depuis l'Observatoire de Paris, Cassini I découvre la division des anneaux de Saturne qui porte son nom. En 1675, il s'interroge sur la nature de l'anneau, et affirme que « l’apparence de l'anneau est causée par un amas de très petits satellites qu'on ne voit point séparément ». Il découvre aussi que celui-ci « est divisé par une ligne obscure en deux parties égales dont l'intérieure était fort claire et l'extérieure un peu obscure ». On appellera cette ligne « Division de Cassini ». Dans le Journal des Sçavants pour l'année 1677, il annonce la découverte et fait l'éloge de la supériorité des lunettes dont il dispose à l'Observatoire Royal.
CASSINI ET LES ANNEAUX DE SATURNE
— Extrait de la lettre de Signor Cassini concernant une tache récemment vue dans le soleil, ajoutée à une remarquable observation de Saturne, faites par lui-même.
« Ensuite, il se divise en deux larges anneaux, apparemment la ligne sombre qui semble elliptique est vraiment circulaire et sépare deux anneaux concentriques, dont (celui de) l'intérieur est plus brillant que l'extérieur. Immédiatement après l’émersion de Saturne des rayons du soleil les anneaux sont visibles toute l'année jusqu'à ce qu’ils disparaissent ; d'abord, avec un télescope 35 pieds, puis un plus petit de 20 pieds. Ce format plus modeste est plus facile (à utiliser). »
la découverte du système solaire
SÉQUENCE 3Les Princes et l'astronomie
Vue de l’éclipse du Soleil MDCCXXIV, Anonyme XVIIIe siècle © Observatoire de Paris
Le 12 mai 1706, en présence du roi, Cassini et Maraldi observent à Marly, une éclipse totale du soleil.
Le 10 juin 1761, le premier passage de Vénus devant le soleil est observé par l’académicien Pierre-Charles Lemonnier, en présence du roi âgé alors de cinquante-et-un ans. Ces passages très rares (en moyenne deux par siècle) permettent alors, selon une méthode suggérée par Halley à la Royal Society, de mesurer la distance de la terre au soleil et suscitent nombre d’expéditions scientifiques. Cet engouement royal se poursuit avec Louis XVI.
Dans les Mémoires de l’Académie royale des Sciences de 1724, on trouve un rapport circonstancié par Jacques Cassini de l’observation de l’éclipse totale du 22 mai 1724 à Trianon en présence du jeune roi, Louis XV, alors âgé de 14 ans.
Au-delà du contexte institutionnel, militaire ou politique, les rois de France s’intéressent aux observations astronomiques.Louis XIV assiste à l’éclipse partielle de soleil du 23 septembre 1699 alors que la Cour est à Fontainebleau. Après avoir examiné le phénomène derrière un verre fumé, il demande à Jean-Dominique Cassini de lui exposer un plan de la trajectoire de l’éclipse dans le monde.
Louis XIV assiste à l’éclipse partielle le 3 mai 1715 au château de Marly, accompagné de son arrière petit-fils, le futur Louis XV.
DES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES À LA COUR : LES ÉCLIPSES
Louis de France, dauphin (fils de Louis XV), Louis Tocqué, 1735-1800© Château de Versailles, Dist. RMN / ©Jean-Marc Manaï
L'ÉDUCATION DES PRINCES
Les savants et les sciences sont au service du roi, et pourtant Louis XIV ne pratique pas les sciences. Il a reçu un enseignement scientifique essentiellement pratique notamment, les mathématiques appliquées à l’arpentage, la cartographie, les fortifications et la balistique.Le programme éducatif de son fils le Grand Dauphin, inclut un enseignement scientifique mêlant leçons particulières et visites à l’Académie, à l’Observatoire et au jardin du roi.L’intérêt scientifique de Louis XV est éveillé par le Régent, et par les visites de cabinets scientifiques de particuliers. Intérêt qu’il conservera toute sa vie. Une charge de sous précepteur pour les sciences est créée pour l'éducation du dauphin, Louis de France qui est pérennisée pour Louis XVI et ses frères. Des programmes éducatifs sont établis, des instruments scientifiques sont fabriqués, faisant des sciences une discipline à part entière dans la formation des princes.
Cabinet de la garde-robe de Louis XVI, 18e siècle©Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Jean-Marc Manaï
Les nombreux décors des appartements publics et privés rappelent aux visiteurs de Versailles et aux Princes, l'importance des sciences qui font partie des attributs de la fonction royale au même titre que le commerce, la guerre, la marine ou les arts.
Louis XV fait fabriquer des instrumensts scientifiques didactiques par l'abbé Nollet qui sont utilisés pour l'éducation des Princes jusqu'à Louis XVI. Ils sont conservés dans les appartements privés ou dans les réserves des Menus-Plaisirs.
Sphère armillaire 1705Jean-Baptiste-Nicolas Delure (fabricant ) d'après Jean Pigeon (mathématicien) © RMN-GP (Château de Versailles) / Droits réservés
DES INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES POUR L'INSTRUCTION DES PRINCES
pour info,
Globe terrestre Dom Bergevin 1784©chateau de Versailles
GLOBE DE MENTELLE
GLOBE DE BERGEVIN
Globe terrestre et célèste Edmé Mentelle 1786© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet
DES GLOBES COMMANDES PAR LOUIS XVI POUR L'EDUCATION DU DAUPHIN
la découverte du système solaire
SÉQUENCE 4La planétologie à l'Observatoire depuis le XVIIIe siècle
À partir de la fin du XVIIIe siècle, les découvertes de planètes vont se poursuivre avec l'astronome anglais William Herschel qui découvre la planète Uranus en 1781. Puis les plus grosses planètes qui composent la ceinture d'astéroïdes sont découvertes à partir de 1801 (Cérès, Pallas, Junon, Vesta). Une découverte retentissante est celle de la planète Neptune en 1846, car elle résulte de l'application des lois du mouvement du système solaire et des calculs de perturbations sur la trajectoire d'Uranus. François Arago et Urbain le Verrier dominent le XIXe siècle à l'Observatoire de Paris, mais on compte aussi les grands savants, Fresnel, Foucault, et Fizeau, qui multiplient les expériences sur la nature de la lumière. La planétologie prend un nouvel essor au XXe siècle avec l'ère spatiale et les missions d'exploration vers les planètes, qui vont jusqu'à se poser sur leur sol (Vénus en 1970, Mars en 1976, Titan en 2004).
Reconstitution du téléscope de Herschel Dist. Commons.wikimedia© Mike Young
LA DÉCOUVERTE D'URANUS, LA SEPTIÈME PLANÈTE DU SYSTÈME SOLAIRE
On sait aujourd'hui qu'Uranus, possède 27 satellites naturels de toute taille, ainsi qu'un système d'anneaux étroits, découverts par la sonde Voyager-2 de la NASA lors de son passage à proximité en 1986.
En 1781, grâce a un télescope de grand diamètre l'astronome anglais William Herschel découvre la planète Uranus qu'il nomme d'abord Georgium Sidus c'est-à-dire l'étoile de Georges, en hommage au roi Georges III d'Angleterre. La planète, prise d'abord pour une comète, s'est appelée la planète de Herschel, et c'est l'astronome allemand Johann Bode qui propose le nom d'Uranus, père de Saturne et grand-père de Jupiter dans la mythologie. En 1787, Herschel va découvrir deux satellites, que son fils John nomme en 1852 en hommage aux personnages du Songe d'une nuit d'été de W. Shakespeare, Titania et Obéron.
Cérès, dite l'été. Moulage d'après l'oeuvre de Jean-Baptiste poultier© Château de Versailles, Dist. RMN / © Didier Saulnier
LA DÉCOUVERTE DE CÉRÈS, PLUS PETITE PLANÈTE NAINE DU SYSTÈME SOLAIRE
On compte aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'astéroïdes ; mais même pris tous ensemble, leur volume total reste inférieur à celui de la Lune.
Lors de la première nuit du XIXe siècle (1er janvier 1801), Giuseppe Piazzi découvre par hasard un nouvel objet du Système solaire, Cérès. Trois objets similaires sont découverts dans les années suivantes : Pallas en 1802, Junon en 1804 et Vesta en 1807. Tous apparaissent situés entre les orbites de Mars et Jupiter et sont considérés comme des nouvelles planètes, bien qu'Herschel propose de créer une nouvelle catégorie, les astéroïdes (du grec aster : étoile et -(o)ide, semblable à) car ils se présentent dans une lunette sous un aspect stellaire (ils n'ont en effet pas de diamètre apparent détectable à cause de leur petite taille). À partir de 1845 et la découverte d’un cinquième astéroïde, Astrée, les découvertes d'astéroïdes entre Mars et Jupiter se succèdent et l'appelation d'astéroïde s'impose au détriment de celle de planète.
Pierre-Simon, marquis de LaplaceGuérin, Jean-Baptiste-Paulin , 1837© RMN-GP (Château de Versailles) / Droits réservés
EMERGENCE DE L'ASTRONOMIE MATHÉMATIQUE
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) contribue au tournant du XIXe siècle, à l'émergence et aux progrès de l'astronomie mathématique. Il démontre que le Système solaire est mécaniquement stable (1773) et émet l'hypothèse cosmogonique selon laquelle le Système solaire serait issu d'une nébuleuse en rotation (1796). Après les travaux de Clairaut, d'Alembert et Euler, son Traité de Mécanique Céleste vient couronner l'analyse mathématique des mouvements célestes, sur lesquels se fondent les découvertes ultérieures, transformant ainsi l'approche géométrique de la mécanique de Newton par une approche basée sur l'analyse mathématique.Grace à ces travaux les astronomes peuvent calculer les orbites de tous les corps du système solaire en prenant en compte leur attractions gravitationnnelles mutuelles. Laplace, qui a participé à la fondation de l'école polytechnique avec Lagrange, fut brièvement ministre de l'intérieur sous le Consulat.
Le Verrier découvre la planète Neptune par ses calculs en septembre 1846 Esquisse peinte par Edmond-Louis Dupain pour un projet de plafond, 1889© Bibliothèque de l’Observatoire de Paris
Phrase célébre prononcée par Arago devant l'Académie des sciences.
" M. Le Verrier vit le nouvel astre au bout de sa plume ".
NEPTUNE, LA PREMIERE DÉCOUVERTE DE L'ASTRONOMIE MATHÉMATIQUE
Peu après avoir dévoilé à l’Académie des sciences, le 31 août 1846, les éléments de la planète perturbant l'orbite d'Uranus et le lieu où on devrait la trouver, Urbain Le Verrier écrit à plusieurs astronomes étrangers qu’il sait disposer d’instruments puissants et surtout de bonnes cartes du Ciel qui n’existent pas à l’Observatoire de Paris. L’un de ces astronomes est Johann-Gottfried Galle (1812-1910), de l’Observatoire de Berlin. Le Verrier lui écrit le 18 septembre 1846, la lettre arrive le 23 septembre, et dès la nuit qui suit Galle découvre la planète.
Le roi Louis-Philippe Ier nomme Le Verrier précepteur pour l’astronomie de son petit-fils Louis-Philippe d’Orléans. La Royal Society of London lui décerne la prestigieuse médaille Copley, puis l’inscrit parmi ses membres étrangers, comme le feront aussi d’autres sociétés savantes.
C'est également à l'Observatoire de Paris que Léon Foucault fait la première démonstration du mouvement de la Terre avec le célèbre pendule qui porte son nom (1851).
Léon Foucaut invente et perfectionne les miroirs de télescopes jusqu'à 80 cm de diamètre. Il est l'inventeur de l'instrument d'astronomie, le sidérostat.
François AragoFuhr, Charles-Jérémie (lithographe)d'après Scheffer, Henry (peintre)- 1852© Château de Versailles
LÉON FOUCAULT À L'OBSERVATOIRE DE PARIS
François Arago (1786-1853) occupe une place prépondérante dans l'Observatoire du XIXe siècle. Il y invite Augustin Fresnel (1788-1827), Léon Foucault (1819-1868) et Hippolyte Fizeau (1819-1896) à réaliser leurs projets scientifiques et y développer leurs nouvelles techniques d'observation (photographie, spectroscopie, mesures de la vitesse de la lumière) pour l'étude des spectres stellaires et du soleil. C'est la naissance de l'astrophysique à l'Observatoire.
Observatoire de Paris. Le télescope de 1m20 en service Anonyme©Bibliothèque de l'Observatoire de Paris
Tout au long du XIXe siècle, les progrès techniques se poursuivent et les instruments de l’astronomie se perfectionnent. Ils se couplent aux développements de la photographie et de la spectroscopie. Les outils mathématiques perfectionnent la détermination des positions des corps dans le système solaire et leurs perturbations gravitationnelles. Le développement des signaux radio-électriques, des chemins de fer, des voyages intercontinentaux conduisent à uniformiser les systèmes de référence et les unités de mesure. Au XXe siècle, les observations planétaires se poursuivent grâce à la spectroscopie, qui permet d'analyser à distance les constituants gazeux dans les atmosphères des planètes. Mais c’est avec l’ère spatiale à partir de 1957, que la planétologie va prendre un essor inégalé, avec les missions scientifiques vers les autres planètes. Grâce aux collaborations internationales (Etats-Unis, Union soviétique, puis Agence spatiale européenne) l’Observatoire de Paris participe à la conception et l’envoi d’instruments de mesure à bord de missions spatiales vers Vénus, Mars, et le système de Saturne avec la mission Cassini-Huygens.
DE LA MÉCANIQUE CÉLÈSTE À LA NAISSANCE DE L'EXPLORATION SPATIALE
La mission d'exploration du système de Saturne va durer plus de 20 ans, entre le lancement en Floride (1997), l'arrivée et l'atterrissage de la sonde Huygens sur Titan (Déc. 2004 – Jan. 2005) et la plongée du vaisseau spatial Cassini dans l'atmosphère de Saturne à la fin de la mission (septembre 2017). Plusieurs équipes de l'Observatoire de Paris ont participé à la conception des instruments et l'exploitation des données scientifiques.
LA MISSION CASSINI-HUYGENS
Un hommage exceptionnel aux découvertes de Cassini et Huygens est rendu lorsque la mission conjointe de la NASA et de l'ESA, Agence spatiale européenne, lancée en 1997 vers Saturne et son satellite Titan, est nommée d'après les deux académiciens royaux.
FOCUSLouis XIV et la figure d'Apollon
Le château fut ainsi dédié à Apollon, présent notamment dans le Grand Appartement et dans les jardins. Ce n’est qu’à la fin des années 1670 que ce langage apollinien allait être supplanté par un autre type de discours, historique, plus explicitement rapporté à Louis XIV lui-même.
LE SOLEIL À VERSAILLES : LA FIGURE D'APOLLON
Dans ses Mémoires, à propos de l’année 1662, Louis XIV s’est expliqué sur sa devise Nec pluribus impar et sur l’usage du soleil comme emblême.
« On choisit pour corps le soleil, qui […], par l’éclat qui l’environne par la lumière qu’il communique aux autres astres qui lui composent comme une espèce de cour, […], par le partage égal et juste qu’il fait de cette même […] lumière à tous les divers climats du monde, par le bien qu’il fait en tous lieux, produisant sans cesse de tous côtés la vie, la joie et l’action, par son mouvement sans relâche, où il paraît néanmoins toujours tranquille, par cette course constante et invariable, dont il ne s’écarte et ne se détourne jamais, est assurément la plus vive et la plus belle image d’un grand monarque. »
Tête d' " Apollon rhodien ", 1660-1680, Anonyme© Château de Versailles, Dist. RMN / © Jean-Marc Manaï
Le char d'Apollon, Charles de la Fosse 1673-1678© Château de Versailles, Dist. RMN / © Christophe Fouin
LA FIGURE D'APOLLON DANS LE CHATEAU DE VERSAILLES
L’enfilade a été modifiée suite à la construction de la galerie des glaces, à l’ajout du salon de l’Abondance, seules restent en place, Vénus, Diane (Lune), Mars, Mercure et Apollon devenue la salle du Trône. A chaque planète étaient associés des héros de l’Antiquité et leurs actions. Ce ne sont pas que les héros antiques, ou les dieux qui sont racontés mais l’histoire de Louis XIV et le portrait du roi.
Au moment de la création des grands appartements, le programme comportait sept pièces qui furent dédiées à des planètes, comme les sept planètes tournant autour du soleil Apollon. L’ordre des planètes n’était pas respecté, même si la chambre avec le plafond d’Apollon était au centre de la disposition originelle.
LA FIGURE D'APOLLON DANS LES JARDINS DE VERSAILLES
Dans les jardins, le thème d’Apollon fut utilisé plus tôt que dans les grands appartements, après 1664 et la fête des Plaisirs de l’Isle Enchantée. Là encore le programme ne fut pas achevé et fortement modifié, mais nous pouvons retenir un axe principal démarrant légèrement décalé sur le côté du château avec la grotte de Thétys, se poursuivant au bassin de Latone, empruntant l’axe du Tapis Vert pour se terminer au bassin d’Apollon. Dans deux allées parallèles au grand axe, se trouvent les bassins des saisons. Le projet originel devait raconter la vie d’Apollon.
LA DÉCOUVERTE DU SYSTÈME SOLAIRE
QUIZ TESTModule 4
La découverte du systÈME SOLAIRE
RESSOURCESPour aller plus loin
Pour aller plus loin dans la découverte du sytème solaire, l'Observatoire de Paris à l'occasion de ses 350 ans propose des exposition virtuelles pour explorer ses recherches. Les collections muséales de l'Observatoire sont accessibles via le portail COSMOS (COllections Scientifiques et Muséales de l’Observatoire de PariS) de la bibliothèque. Les documents numérisés (imprimés, manuscrits, iconographie…) et les expositions en ligne sont disponibles à partir du portail web bibnum.L'ensemble des collections de la bibliothèque de l'Observatoire de Paris peut également être consulté à partir du portail unique Télescope.Les oeuvres de Versailles présentées sont accessibles et téléchargeables en haute définition dans le site Collections. Certaines d'entre-elles sont consultables sur le site photo de la RMN.
S.Bonald, Château de VersaillesL.Girard, RMN pour le Château de VersaillesN.Robichon, Observatoire de Paris - PSLT.Widemann, Observatoire de Paris - PSL
Nous vous remercions de votre participation et souhaitons que ces modules vous ont donnés satisfaction. Un questionnaire vous sera adressé pour nous permettre d'améliorer nos propositions futures.
